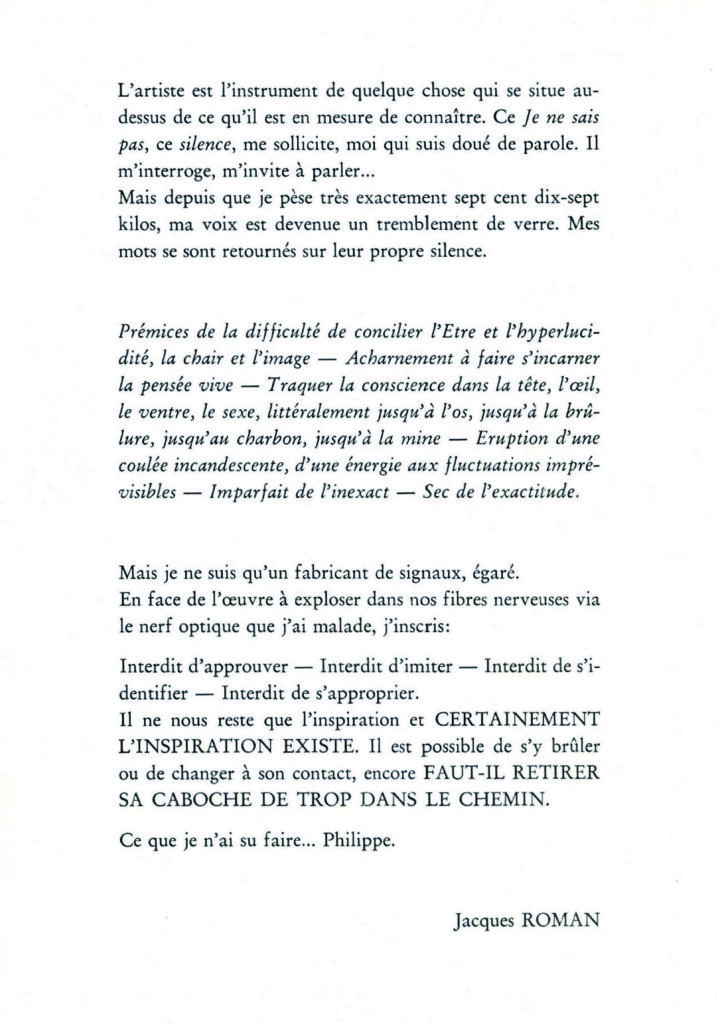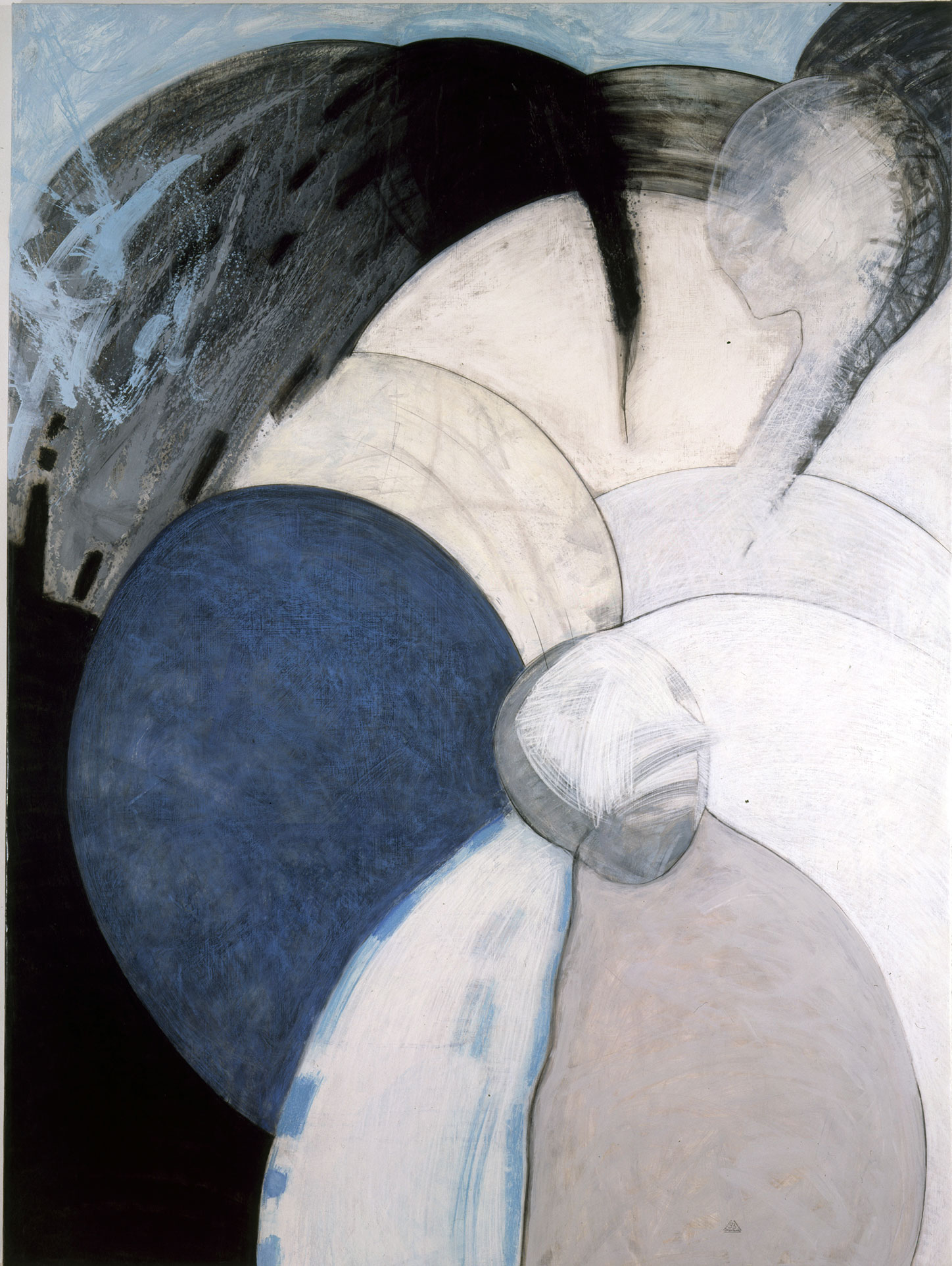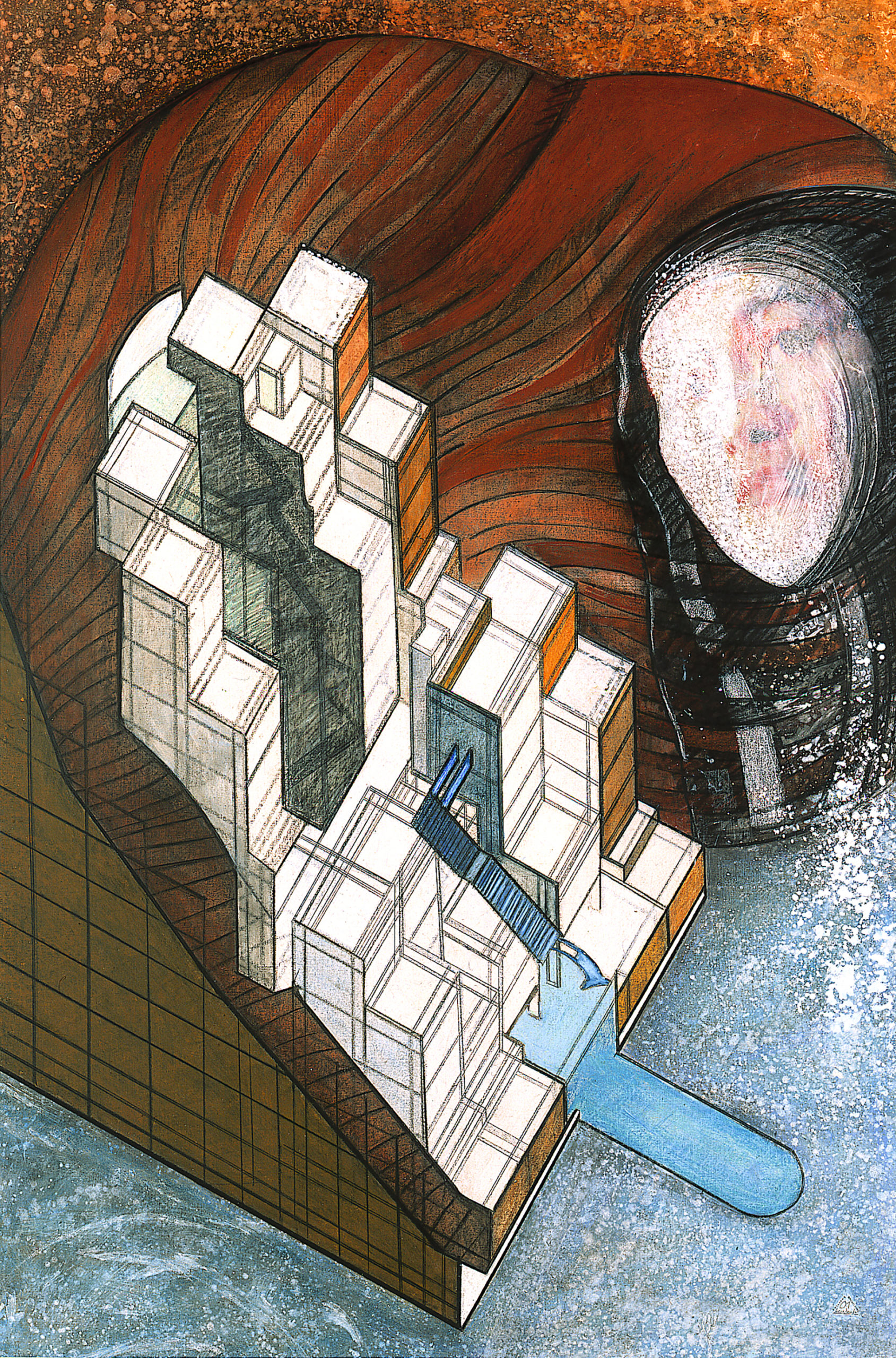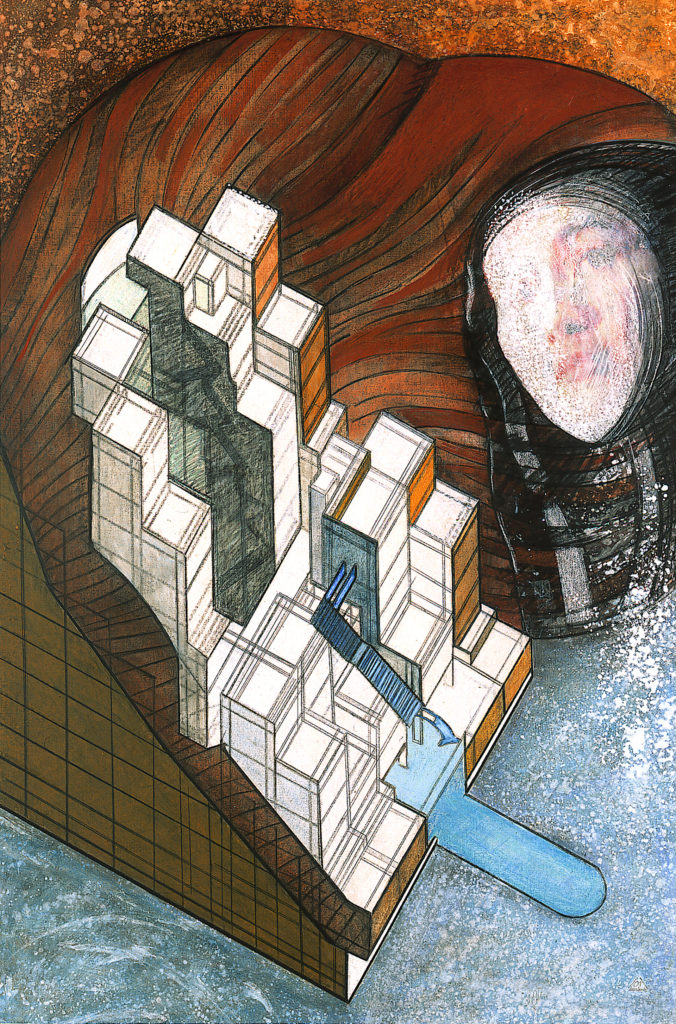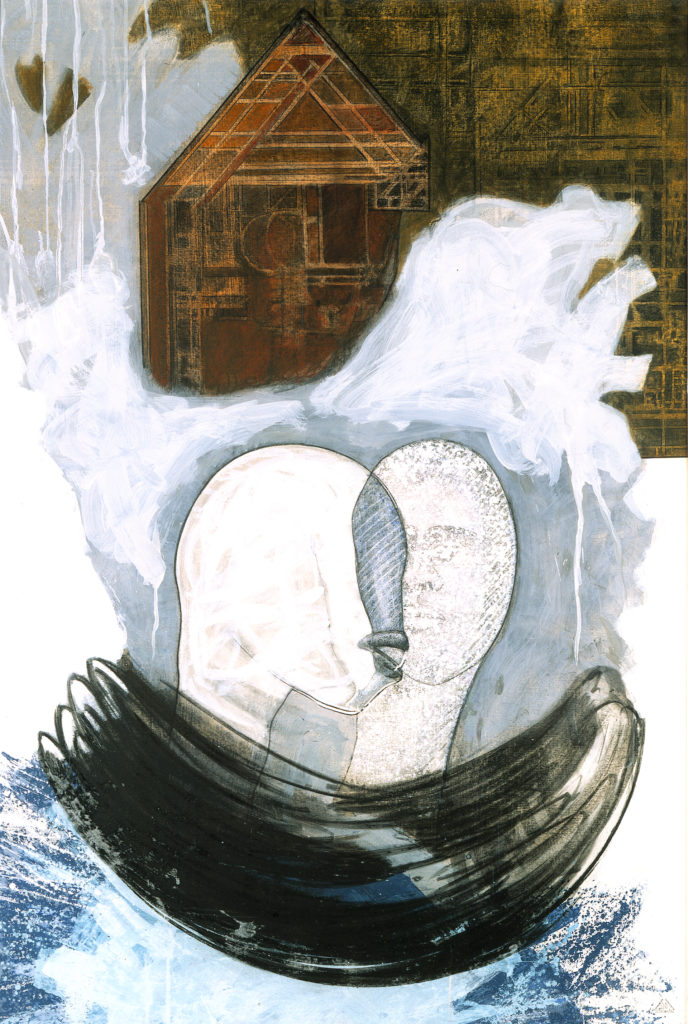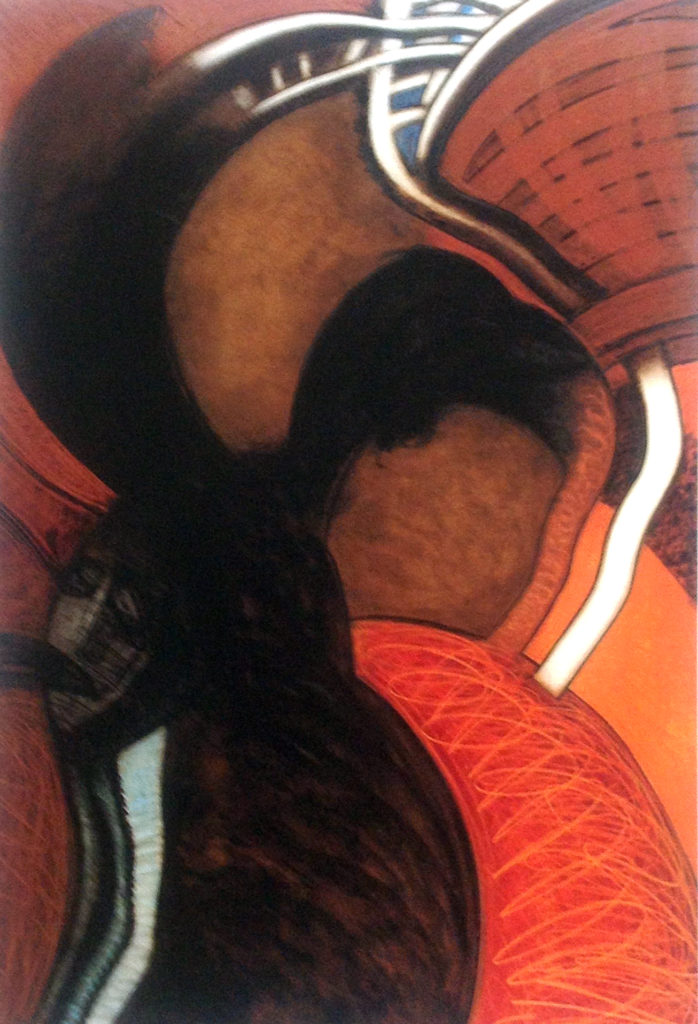DEDALE DE LA MORT – Georges HALDAS
On avait décidé que, pour une fois, chez M., je dormirais dans la grande chambre au rez-de-chaussée. Si accueillante, pacifique et discrètement chaleureuse. Pour me remettre de plusieurs semaines de travail à haute tension et de fatigue nerveuse. Mais au lieu du repos escompté, ce soir-là, dès les premières minutes, et sans raison apparente, je fus pris, sur le lit-canapé, pourtant confortable, d’un curieux malaise. Inhabituel. Avec une impossibilité, plus inhabituelle encore, de trouver le sommeil. Et même de lire, comme il m’arrive d’ordinaire en pareil cas. Non seulement de la difficulté à me concentrer, mais une nervosité tout à fait mal venue. Inexplicable elle aussi. Accompagnée d’une inquiétude, vague d’abord, mais qui bientôt fit place à l’angoisse ; et celle-ci même, au bout de peu de temps, à de la peur. Peur sourde, irraisonnée. Dont je voulus me moquer, à mes propres yeux, pour la conjurer. Mais qui, bizarrement, n’en prenait par là-même que plus de force. Et qu’il me semble, depuis mes lointaines années d’enfance, n’avoir plus éprouvée. Au point que les objets les plus familiers de cette chambre, qui me plaisent, et même me sont chers – que des fois, loin de cette maison, j’y pense avec affection, avec tendresse, comme à de vieux amis : la lampe à pied dans son coin ; les candélabres ; les rideaux jaunes ; le lutrin de bois – ces objets, tout à coup, m’apparurent inquiétants. Pire : comme chargés d’une hostilité magique. Je veux dire : porteuse de mauvais sort. Faisant peser sur l’ensemble de la pièce une menace diffuse, d’autant plus désagréable, et irritante, qu’il ne m’était pas possible, encore une fois, d’en déceler l’origine, ni d’en déterminer exactement la nature. C’était, par exemple, comme si, des candélabres posés sur le piano, deux serpents allaient sortir, et, sans autre, se diriger vers moi. Comme si, également, la belle affiche de San Giminiano, au mur, avec ses tours rivales, était sur le point de se déchirer pour laisser apparaître, dans une anfractuosité de la paroi, la face d’un cadavre à demi-décomposé. Et ainsi de suite. Bref, toute la pièce était comme habitée par une présence maléfique. Qui faisait que même Patka, la chienne, qui d’ordinaire repose à mes pieds dans la plus grande confiance et un total abandon, s’était mise à s’agiter, à se lever, à tourner en rond dans la chambre. Allant vers la porte-fenêtre donnant sur la terrasse. Revenant. Cherchant, mais en vain, une place favorable sous le piano, près de la cheminée ou sous le poste TV. Et au passage, chaque fois, me léchant les mains, comme inquiète elle aussi et désireuse, on aurait dit, de me témoigner, en un moment difficile pour moi, son affection. Et sa fidélité. Puis se dirigeant de nouveau vers la cheminée, et grattant soudain le sol avec énergie. Ce qu’elle ne fait que rarement. Pas de doute, il se passait – il se préparait – quelque chose. J’essayai néanmoins, à plusieurs reprises, ayant renoncé à toute lecture, de m’endormir. Impossible. A un moment, même, j’éteignis la lampe, que sous le coup de l’angoisse et de ma peur naissante j’avais laissée allumée. Comme pour les conjurer ; et conjurer les manœuvres de l’éventuel ennemi dans la place. J’éteignis donc. Mais l’obscurité, loin de m’apporter le sommeil, ou, à défaut, un peu d’apaisement, ne fit qu’accentuer l’état de malaise qui m’avait gagné. Et la conscience d’une présence maligne. A travers la porte-fenêtre, à demi-ouverte, se détachant dans l’ombre opaque, il me semblait que les branches du pommier nain, sur la terrasse, remuaient avec force, bien que la nuit ne fût traversée par aucun souffle. Et c’était comme si ces branches sombres, se profilant sur un fond vaguement moins sombre, m’adressaient des signes cabalistiques, dont j’étais incapable cependant de capter le sens. Et le message. A un certain moment même, il me sembla qu’une fugitive clarté blanche, comme celle d’une lampe de poche, balayait par intermittence la terrasse. Des cambrioleurs ? Si seulement. Car de ceux-ci, franchement, je n’ai pas l’ombre d’une peur. Ce sont des hommes comme vous et moi. Je me levais néanmoins, par acquit de conscience, pour aller jeter un coup d’œil sur la terrasse. En avoir le cœur net. Bien entendu, rien. Une nuit, en effet, plus que calme. Aucun souffle. Etoiles brillantes dans un ciel de juin sans nuage. Les arbres familiers. Dont pas une branche, effectivement, ne remuait. Y compris celles du pommier nain. Je rentrai. Mais je n’avais pas repris ma position étendue sur le lit-canapé, que tout redevint sournoisement menaçant dans la chambre : le piano à queue ; les candélabres ; le tapis ; les rideaux. Et dans leur immobilité même, à présent, les feuillages des grands arbres. Qui, il y a quelques instants encore, m’avaient donné une rassurante impression de calme. Quant à la chienne, installée de guerre lasse à mes pieds, de nouveau, elle s’était endormie. Mais d’un sommeil traversé de soubresauts. Et en poussant, de temps à autre, des grognements, des gémissements même, auxquels succédaient des soupirs prolongés. Comme on dit, dans les histoires fantastiques, qu’en poussent les âmes errantes des défunts. Sur quoi, je venais un peu de m’assoupir, le menton sur la poitrine, quand la chose terrible se produisit. Je veux dire que, tout à coup, je suis secoué dans mon lit par une épouvantable explosion. Quelque chose comme un coup de canon à bout portant ou un éclat de tonnerre. Mais plus encore, dans la seconde même, la sensation foudroyante d’une balle de revolver, que quelqu’un, ayant pénétré dans la pièce par la porte-fenêtre entr’ouverte, avait tiré sur moi. Incroyable, soit dit en passant, le nombre de choses qui, sous le choc, et la conscience suraiguë d’avoir été traversé par le projectile, ont défilé dans ma tête. Et, une fois de plus, me font penser, pendant que j’écris après coup ces lignes, à quel point le fond de notre être, l’intime de l’intime en nous, échappe au temps (il ne s’agit pas là, on le voit, d’une réflexion, mais d’une expérience). En fait, et pour en revenir à l’explosion, pour tout dire aussi, j’avais davantage été fusillé par la surprise de la détonation que par la détonation elle-même. Si bien que je fus en proie, dans la seconde même, à la question lancinante, qui l’emportait, je me rappelle, sur l’épouvante : non pas tant qui avait bien pu tirer sur moi ? Mais pourquoi avait-on tiré ? Qu’avais-je fait en outre pour motiver cette agression ? Et je me rappelle encore que dans ce prodigieux instantané j’eus le loisir de passer en revue certains épisodes de ma vie, certains actes, certaines décisions, certaines pensées et réactions qui, pour n’être pas précisément glorieux, étaient loin, me semble-t-il, de mériter la mort. Quant à la conscience suraiguë que j’ai dite – aussi étrange que suraiguë – d’avoir été traversé par une balle, elle était faite, me semble-t-il, de deux éléments distincts à la fois et absurdes dans leur coexistence ; d’une part, en effet, j’avais le sentiment que la balle m’avait traversé de part en part dans la région du cœur ; et, de l’autre, que j’avais été fendu en deux, comme une bûche, par un magistral coup de hache ; et que j’étais en train de perdre en abondance mon sang. Mais cette hémorragie même prenait en l’occurrence une tournure tout à fait particulière. En ce sens que ce n’était pas physiquement que je sentais mon sang couler – pas de liquide, à proprement parler, tiède et gluant – mais bien psychiquement. Un sang, oui, psychique. C’était la vie elle-même qui me semblait s’échapper de moi avec douceur. Mais une douceur inexorable. Et particulièrement cruelle dans la mesure où, n’éprouvant en réalité aucune douleur, et ayant à faire à un phénomène pas du tout brutal, je me sentais néanmoins incapable d’endiguer cette perte progressive. Incapable de m’y opposer. De réagir. De sorte que c’était dans un état de paralysie totale que j’assistais à la mort lente qui était en train de m’envahir. Et que je la subissais. En cela résidait donc, et non, encore une fois, dans la violence du choc ou de la douleur, le paroxysme d’une angoisse confinant à la terreur. Tout animal, touché par la mort, se débat. J’aurais voulu me débattre. Je ne le pouvais pas. Une main de fer me tenait cloué, qui n’était pas celle de l’agresseur inconnu. Impossible, sous cette pression, d’esquisser le moindre geste. Pire encore. Je veux dire : plus même capable, face au danger, de ce mouvement psychique premier, élémentaire, qui, partant des entrailles, monte, à l’intérieur de notre corps, comme une vague porteuse, en guise d’écume, à son sommet, du cri. Un cri d’horreur qui, en même temps, est un appel. Non. Pas de vague, ici, pas d’écume, ni de cri. Cependant que la vie – le sang psychique – continuait de se retirer de moi. Comme une marée descendante. Cette sensation, dans laquelle grouillaient mille autres impressions, étant si intense, dans son horreur douce qu’à l’heure où je consigne la chose, elle m’habite encore ; et que j’en éprouve, dans son intégralité, l’épouvantable richesse et complexité. Un abîme sauvage. Impuissant donc à manifester quoi que ce soit, incapable du moindre mouvement, j’ai tenté, en désespoir de cause, pour faire monter en moi le cri et l’appel, de lever malgré tout les deux bras. Comme un malade, à bout, ou un suppliant. Peine perdue. Mes bras ne répondant plus à cette sollicitation ultime, je me sentis soudain, sur mon lit-canapé, réduit à un état, véritablement, d’homme-tronc. Duquel rien, absolument rien ne pouvait émaner. Pour empêcher la mort de me gagner. Plus exactement : la vie de s’en aller (ce qui ne revient pas tout à fait au même). Sans que je puisse, si j’ose dire, la suivre. En attendant, l’homme-tronc, que j’étais devenu, n’avait plus d’autre ressource, désormais, que de se demander où avait pu passer l’agresseur, que, dans l’obscurité, je ne voyais pas, mais dont j’imaginais qu’il s’était introduit dans le hall ; et que, de là, peut-être, il était monté dans les chambres où reposaient M., sa fille et leurs amis. Mais sans pouvoir, naturellement, vu ma situation et mon état, les avertir de cette présence, et prévenir ainsi d’éventuels méfaits. Mais je ne m’attardai pas, je me rappelle, à ces suppositions. Mobilisé que j’était par la question, peu réconfortante, de savoir combien de temps il faudrait encore au flux de la vie pour me quitter définitivement.
Or, c’est à ce moment précis de la plus basse dépression – le fond du trou et le commencement de l’abîme – que cette agonie entra, pour ainsi dire, dans une phase nouvelle. Où, renonçant même à lever les bras, je me mis, comme un spéléologue descendant dans les profondeurs, à la recherche de ma voix. Pour, au moins, parvenir à crier. Mais voici que, nouvelle horreur, ma voix elle-même était devenue inaccessible. A la limite, existait-elle encore ? J’essayai pourtant, rassemblant toutes les puissances intimes de mon corps, d’aller à sa rencontre. Mais elle était comme retranchée. Derrière une épaisse paroi rocheuse. Et frappée elle aussi, je le sentais, de paralysie. Morte ? Peut-être. Mais prête, en même temps, me semblait-il, à ressusciter. Comme Lazare. Toujours est-il que dans cette catastrophe – mais comment rendre par des mots successifs, comme je le fais en ce moment, la fulgurance de ce qui m’arrivait en une fraction de seconde, muée en éternité – elle restait, ma voix, en dépit de son état cataleptique, mon unique recours. Encore que j’eus l’impression, durant quelques instants, que ce recours lui-même m’était ôté. Et c’était, je me rappelle, comme si m’était ôtée la moelle de mes os. Cela dit, malgré la balle qui m’avait traversé, et le flux de la vie qui se retirait de moi, j’avais la curieuse sensation, mourant, de n’être pas mort – puisque j’avais pleine conscience de ce qui m’arrivait – mais, en même temps, de n’être plus vivant tout à fait. Bref, et à l’instar de ma voix, quelque chose comme un vivant emmuré dans un cachot. Qui était celui même de la mort. Et où la mort, me tenant à sa merci, allait m’achever. Mais chose plus étrange encore, et complexe, à un moment donné, dans ma lutte désespérée pour retrouver ma voix, et ne pas succomber à la paralysie générale, je cessai soudain d’être angoissé. Plus de peur, ni d’épouvante. Tous mes efforts désormais étaient concentrés sur un point : me libérer de ma prison en retrouvant la voix. Malgré la non-réponse de celle-ci. Et la retrouver, non plus donc en m’efforçant de crier, mais en mimant, en quelque sorte, intérieurement l’acte de crier. Me comprendra-t-on si je dis, pour reprendre l’image du spéléologue : en me glissant dans un goulet de silence vers le lieu même où le cri me paraissait possible. En d’autres termes, dans la grotte où la voix était tapie. Non perdue, encore une fois, mais empêchée. Anesthésiée. Et qu’il me fallait donc, à tout prix, réveiller. Réanimer. Energie assoupie qui n’était plus en possession de sa faculté sonore. Mais la détenait en puissance. Et c’est à cette puissance virtuelle que, de tout mon être affaibli, je m’adressais. Avec, soudain, miracle, un semblant de résultat. Une aube, si j’ose dire, de voix. Pas encore un son déclaré. Un vague murmure. Un prélude. Correspondant, me semblait-il, à un léger dégel. Un déblocage intime, mais réel, de la situation. Qui, du coup, décupla mes forces. Ce dont je profitai, naturellement, pour tirer le maximum de cet avantage inattendu. A savoir, passer de ce murmure, encore étouffé, à une émission incertaine, sans doute, rauque, confuse, mais continue déjà. Et qui me faisait sentir, avec une joie qui n’osait pas se déclarer, que peu à peu je regagnais du terrain. Le son devenant de seconde en seconde, en effet, plus consistant, plus mûr. Comme on le dit d’une toux. Bref, je rentrais, comme par paliers, en possession de ma voix. Mieux, je me rendais compte, en même temps que ma voix retrouvait ses pouvoirs, sa nature de voix, sa capacité sonore et celle donc de transmission, que, me reprenant moi-même, je retrouvais mes assises. Voix et vie, en l’occurrence, se prêtant appui, ne faisaient plus qu’un. Et cela est si vrai que je sentis avec un bonheur indicible que j’étais en mesure désormais de me faire entendre, ne fût-ce que faiblement ; et que j’eus la certitude, soudain, que j’allais même pouvoir bientôt crier, autrement dit appeler. Et par conséquent me mettre en relation avec l’au-delà de mon ghetto, de mon immobilité sinistre, de mon tombeau. Toutes les énergies, en moi, étant en train d’évoluer dans ce sens, je m’aperçus avec non moins de joie que mes bras, également, cessant d’être de plomb, allaient bientôt pouvoir eux aussi m’obéir, se lever et, se levant, accompagner de leur lente libération une voix en passe de retrouver tous ses moyens. Et grâce à laquelle j’allais sous peu – tout cela se passant, je le répète, dans un millième de seconde – avec toutes mes forces retrouvées appeler à l’aide, alerter la maisonnée. Pour démasquer l’agresseur et, si possible, le prendre en chasse. Et c’est bien, effectivement, ce qui se produisit. J’eus conscience, quelques secondes plus tard – l’illusion de quelques secondes plus tard – de crier avec la plénitude d’une voix remontée des abîmes, fortifiée par cette remontée, et liée de nouveau à ma vie miraculeusement retrouvée. En même temps qu’à l’aide de mes bras, libérés désormais, je m’aidais à me dégager de la masse épaisse des ténèbres où j’avais été jusque-là englué, asphyxié, comme dans une nappe de goudron. Mais au moment même où j’atteignais le sommet de mon cri libérateur, correspondant à la libération définitive de tout mon être, je m’éveillai. Moins étonné, à vrai dire, de me retrouver à l’état de veille, après cette plongée, et cette station, dans les couloirs de la mort, que de constater que personne, à l’étage supérieur de la maison, n’avait bougé. Comment M., sa fille, et leurs amis, avaient-ils pu ne pas entendre la terrible déflagration ? Non plus que, par la suite, mon cri porteur de vie. Certes, j’avais rêvé. Mais ce que je venais de vivre, à travers ce rêve, était réel. Aussi réel que le silence de la maison endormie, à cette heure, la tranquillité innocente dans laquelle baignaient, à présent, les objets familiers de la pièce, et qui, du coup, avaient cessé d’être menaçants. Certes, il n’y avait eu ni détonation, ni balle, ni agresseur. Mais la péripétie, au cours de ce cauchemar, avait été vécue, encore une fois, avec un tel degré de réalité, qu’il se confondait avec celui propre à l’état de veille. Ce degré de réalité faisant le pont, si je puis dire, entre rêve et vie éveillée.
A ce propos, et pour terminer, quelques brèves considérations. Il y a donc une réalité sous-jacente commune au rêve et à l’état de veille. Dont le signe indiscutable est le vécu. Bien qu’il n’y ait eu ni agresseur, ni balle, ni détonation dans la chambre, j’ai indiscutablement vécu, en effet, et la détonation, et le déchirement de la balle, la paralysie consécutive à la blessure, la perte lente du sang psychique ; non moins que les efforts répétés pour retrouver la voix et, par la voix, le cri. Que ce vécu l’ait été en rêve, peu importe. Il est pour moi réel. De cette réalité qui transcende le temps et l’espace, et échappe, en même temps, aux catégories usuelles : rêve et vie éveillée. Qui n’en sont, en fin de compte, que les deux faces. La preuve irréfutable, ici, que mon cauchemar touchait à cette réalité première, antécédente au rêve et à l’état de veille, est que mon corps a été altéré, en l’occurrence, par la péripétie. Je veux dire – et ici entre en jeu la part de bouffonnerie inhérente à toute expérience vitale – qu’au moment où je voulus, après mon réveil, me rendre dans le jardin pour, je m’excuse, lâcher un petit fil derrière le pommier nain que j’aime, en son fouillis de branches presque fraternel, je ne pus, à mon grand étonnement, tôt mué en angoisse (de nouveau), émettre la moindre goutte. Comme sous l’effet encore de la paralysie qui m’avait étreint durant le cauchemar et l’état de pétrification auquel j’avais été soumis. « Ca y est, me dis-je dans un éclair, et en me sentant pétrifié toujours, la prostate ». Dont mon rêve n’aurait été alors qu’une vulgaire annonce ? Comme réalité, on ne pouvait faire mieux ! Et de gamberger, à partir de là, dans tous les sens qu’on imagine. A tort d’ailleurs. Puisque, deux heures plus tard, tout était, si j’ose dire, rentré dans l’ordre. Mais je m’arrête. La question que je lègue, ici, à chacun, et à laquelle, bien entendu, je suis incapable moi-même de répondre, étant : pourquoi ce cauchemar ? Pour me révéler peut-être, expérience à l’appui, l’existence de cette réalité ultime en laquelle s’enracinent le rêve et l’état de veille. D’où l’interdépendance de ces derniers. Bref, mon cauchemar aurait eu, en ce sens, une fonction. Éclairante quant à l’essence de notre condition. Comment regretter dès lors, en dépit de moments terribles, qu’il se soit produit ? Si je donnais dans l’exaltation, je dirais : « Je bénis les instances supérieures de la vie qui me l’ont envoyé. L’ont suscité en moi ». Mais comme l’exaltation n’est pas mon fort, je ne les bénis pas. Simplement, je les en remercie.